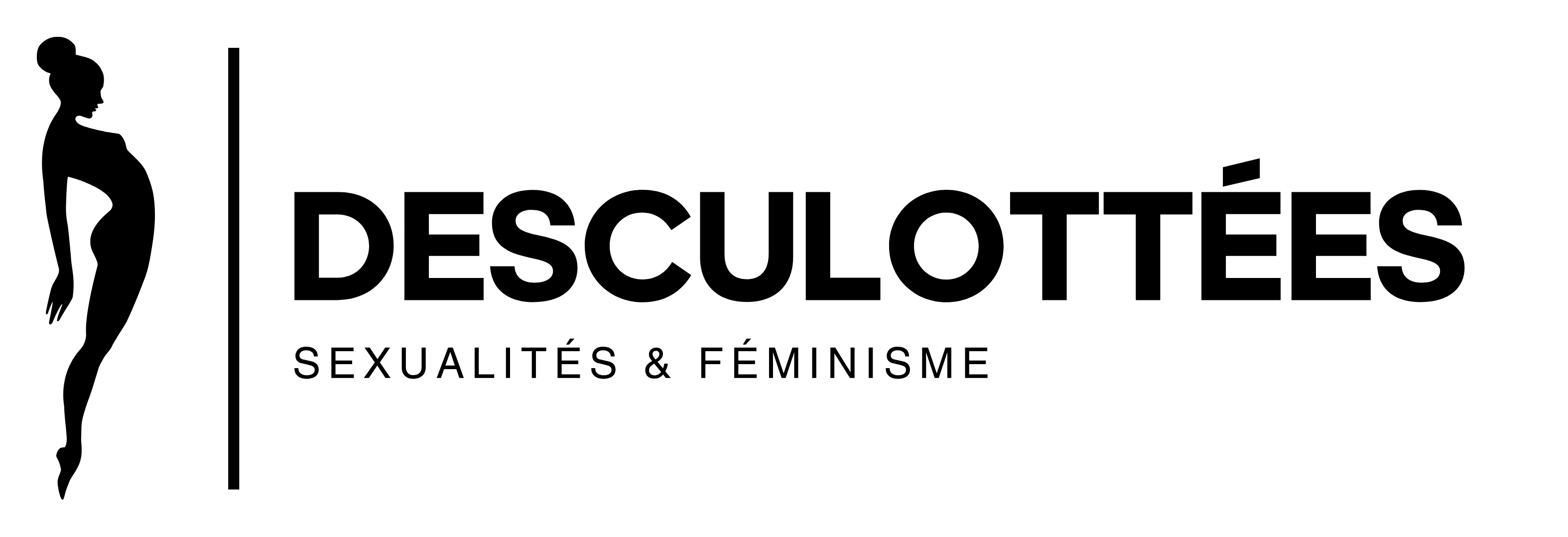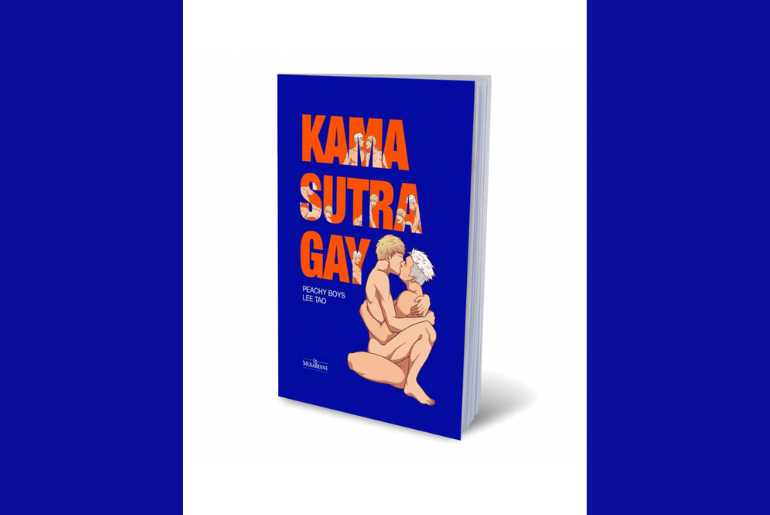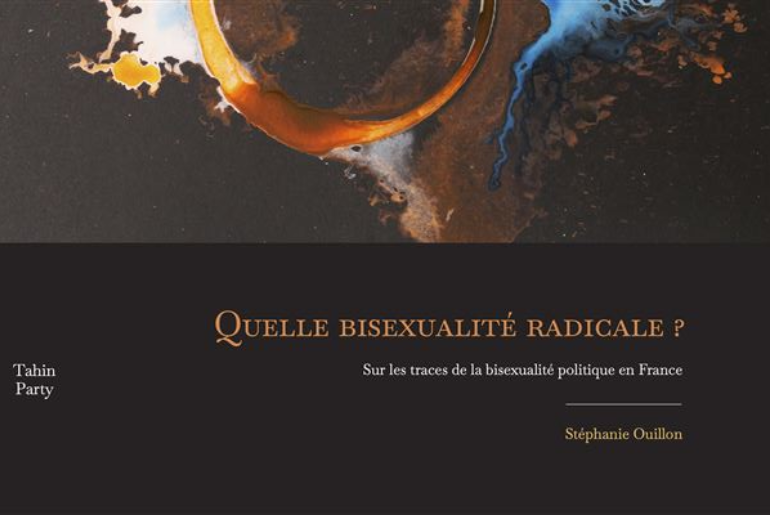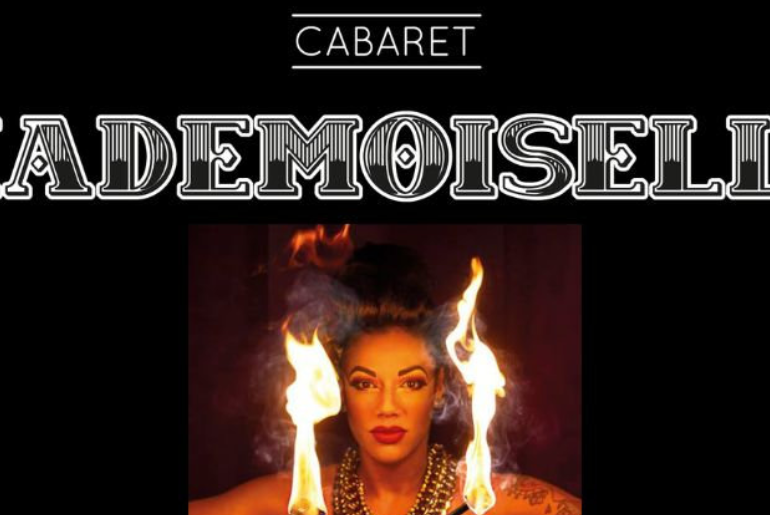Connaissez-vous le concept de mariage lavande ? Né d’une nécessité de survie pour les personnes LGBTQIA+, il s’affirme aujourd’hui comme un mode relationnel assumé, parfois politique ou administratif.
C’est quoi un mariage lavande ?
Le mariage lavande désigne une union entre deux personnes dont au moins une est queer, et où le mariage n’est pas motivé par la romance hétéro-normée classique. Il peut s’agir :
- d’un mariage entre deux personnes queer,
- d’un mariage entre une personne queer et une personne hétérosexuelle,
- ou d’un mariage entre des personnes dont l’objectif n’est pas (ou pas uniquement) amoureux.
À la base, il s’agit d’un mariage stratégique : un arrangement consentant qui permet de se protéger, d’être reconnu administrativement ou de cohabiter dans un cadre social sécurisant pour toutes les parties.

Pour découvrir d’autres notions clés des sexualités LGBTQIA+, vous pouvez lire Sexo Queer : le guide d’éducation sexuelle qu’on attendait tou·tes.
Un héritage historique pour survivre à l’homophobie
Avant de devenir un choix empowerment, le mariage lavande était d’abord… un moyen de survie.
Pendant une grande partie du XXᵉ siècle l’homosexualité était criminalisée, pathologisée ou socialement intenable. À noter que dans le monde, 65 pays ou juridictions criminalisent encore les relations entre personnes de même sexe, et en Afrique, 32 des 54 Etats reconnus par l’ONU interdisent l’homosexualité en 2025.
Beaucoup de personnes LGBTQIA+ ont été contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle pour éviter :
- la prison,
- la perte d’emploi,
- l’exclusion familiale,
- ou pire : la violence voire la mort
Le mariage lavande permettait ainsi d’afficher une façade hétérosexuelle « rassurante », de protéger une homosexualité vécue en parallèle, de bénéficier d’un statut social plus stable.
Certaines femmes lesbiennes et certains hommes gays se mariaient entre eux, parfois même avec tendresse et solidarité, pour faire écran à la société. D’autres épousaient une personne hétérosexuelle informée et bienveillante, dans un pacte respectueux. Le mariage lavande était donc un bouclier contre l’oppression.

Pour mieux comprendre les questions d’orientation, vous pouvez lire aussi l’article Identité sexuelle : comprendre les orientations sexuelles.
Du camouflage forcé à un nouveau mode relationnel assumé
Dans beaucoup de pays, la situation a évolué : les droits LGBTQIA+ avancent, la visibilité augmente, et il n’est plus nécessaire de cacher son orientation pour se marier. Les motivations actuelles d’un mariage lavande sont donc différentes :
Des raisons administratives
- obtenir un statut de couple pour des démarches de résidence, d’héritage ou d’assurance,
- partager un logement ou des finances en toute sécurité.
Des raisons relationnelles
Certaines personnes queer préfèrent un mariage basé sur :
- la stabilité,
- la solidarité,
- un engagement « partenaire de vie » sans pression romantique ou sexuelle.
Des enjeux politiques et communautaires
Le mariage lavande peut être un acte affirmé pour se définir autrement que dans le cadre hétéronormatif.
Pour les personnes queer vivant dans des pays où leurs relations ne sont pas reconnues, il reste aussi une manière de protéger un·e partenaire ou un·e ami·e.
Un choix intime
Le mariage lavande n’est ni une fraude, ni un mariage de convenance désincarné.
C’est une manière de réinventer le couple en fonction de ses besoins réels : sécurité, stabilité, amitié profonde, entraide, liberté afférente à l’identité queer.
Pourquoi appelle-t-on cela « mariage lavande » ?
Historiquement, la couleur lavande n’a pas toujours été un symbole positif. Elle a d’abord été associée à une forme de stigmatisation des personnes queer. Au début du XXᵉ siècle, on parlait de “streak of lavender” pour désigner de manière méprisante un homme perçu comme efféminé ou homosexuel. Lla symbolique du violet/lavande s’est ancrée, au sens large, dans l’idée d’une existence queer marquée par la surveillance, la marginalisation et le danger.
Dans les années 1960–1970, les communautés LGBTQIA+ ont réapproprié le violet et la lavande comme un emblème de résistance. D’une couleur associée au stigmate, c’est devenu une couleur de lutte, de visibilité et d’empowerment.