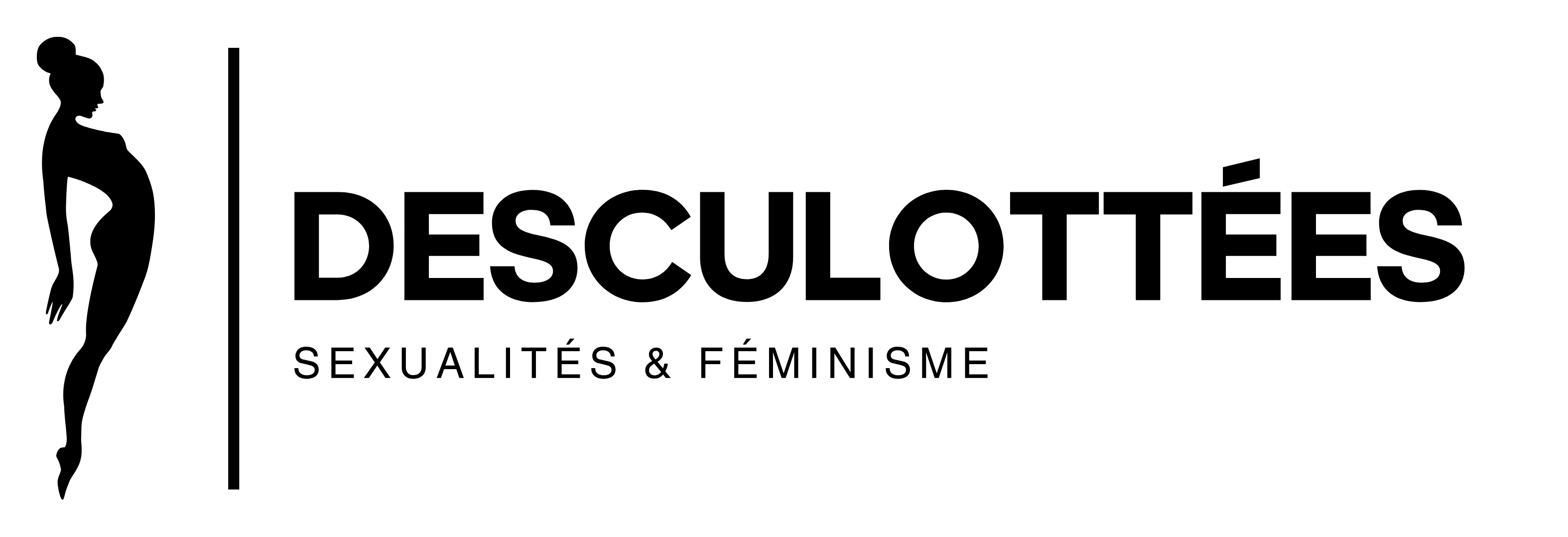La France vient (enfin) de publier sa première stratégie pour une diplomatie féministe (2025-2030). Un texte qui promet de mettre l’égalité de genre au cœur de la politique étrangère. Un signal fort, certes, mais encore faut-il que les moyens suivent…
Pourquoi une diplomatie féministe, maintenant ?
C’est officiel : la France a désormais une stratégie internationale pour une diplomatie féministe, rendue publique par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion de la 4ᵉ Conférence des diplomaties féministes à Paris.
Concrètement, cela veut dire que l’égalité femmes-hommes, les droits LGBTQIA+ et la lutte contre les violences de genre doivent désormais guider toutes les décisions extérieures de la France — qu’il s’agisse de commerce, de climat, de paix ou de culture.
La France place les droits des femmes et des filles et l’égalité de genre au cœur de sa politique étrangère », affirme le texte officiel
Ce tournant n’arrive pas par hasard. Il intervient dans un contexte mondial où les droits des femmes reculent : coupes budgétaires, régressions sur l’avortement, montée des conservatismes… Face à ces attaques, affirmer une diplomatie féministe, c’est dire haut et fort que les droits des femmes sont une question de paix et de démocratie.
À lire aussi : Les pays dirigés par des femmes comptent-ils vraiment moins d’inégalités de genre ?
Cinq grands piliers pour transformer la politique étrangère
La stratégie s’articule autour de cinq piliers qui forment la colonne vertébrale de la diplomatie féministe française :
- Les droits et libertés : défendre partout le droit à disposer de son corps et à vivre sans violence.
- La participation : renforcer la présence des femmes dans les lieux de décision — pas seulement en politique, mais aussi dans la diplomatie, les négociations de paix ou le numérique.
- La lutte contre les violences de genre, sous toutes leurs formes.
- Les ressources : garantir des financements pérennes pour les organisations féministes et les politiques d’égalité.
- La méthode féministe : former, écouter, évaluer et agir de manière cohérente, avec une approche participative.
« La diplomatie féministe de la France est fondée sur l’égalité des droits, le respect des libertés fondamentales et la justice sociale. »
Sur le papier, cette approche coche toutes les cases : droits humains, intersectionnalité, climat, numérique, gouvernance, santé… bref, une vision transversale du féminisme.
Mais comme souvent, la vraie question reste : comment la France va-t-elle passer de la théorie à la pratique ? Comme le chante le rappeur Tiakola « Trop de déclarations suffiront pas, faut qu’il y ait les actes avec ».
Les droits sexuels et reproductifs au cœur du texte
Bonne nouvelle : la stratégie place les DSSR (droits et santé sexuels et reproductifs) au centre de sa politique extérieure.
« La défense des droits et santé sexuels et reproductifs, dont le droit à l’avortement sécurisé, est la pierre angulaire de la diplomatie féministe française. »
Autrement dit, la France s’engage à défendre activement le droit à l’avortement et l’accès à la santé sexuelle dans ses relations internationales — que ce soit à l’ONU, au G7, au G20 ou au sein de l’Union européenne.
Une priorité qui résonne avec le travail de nombreuses associations comme Equipop, qui milite depuis plus de vingt ans pour que les politiques de développement intègrent les droits sexuels et reproductifs.
Mais sans financements, les belles paroles ne suffisent pas
Sur le terrain, les chiffres font grincer des dents. Le Fonds de Soutien aux Organisations Féministes (FSOF), pourtant censé être pérennisé, a subi plusieurs coupes budgétaires. Et certaines contributions, comme celle au UNFPA, n’ont même pas été versées.
« Le discours français ne sera légitimé que par des engagements financiers significatifs », rappelle Equipop.
Selon la loi de 2021, 75 % de l’aide publique au développement doit avoir l’égalité de genre comme objectif d’ici 2025. Mais la réalité est tout autre : la France n’en est qu’à moins de 50 %.
Et comme le dit bien Adam Dicko, militante malienne citée dans le rapport :
« Il ne faut pas que les financements déterminent les besoins, mais que les besoins déterminent les financements. »
Une diplomatie féministe participative (ou rien)
L’autre enjeu, c’est de construire une diplomatie avec les premières concernées : associations féministes, chercheuses, militantes locales, collectifs LGBTQIA+.
Le texte parle d’une “méthode participative” et prévoit un cadre de redevabilité, autrement dit des indicateurs pour suivre les avancées. Encore faut-il que ce cadre soit réellement co-construit et transparent.
Dans cette optique, la France soutient la création de l’Alliance Féministe Francophone (AFF), portée par Equipop, la FIDH et le Fonds pour les Femmes en Méditerranée. L’objectif ? Donner plus de visibilité aux féministes francophones dans les espaces internationaux, tout en garantissant la sécurité des activistes.
À lire aussi : Stéréotypes de genre : un retour en arrière chez les jeunes ?
Une stratégie prometteuse qui donne de l’espoir, mais fragile
Sur le papier, cette diplomatie féministe française a tout pour inspirer : vision globale, valeurs progressistes, ambition affichée. Mais sans moyens, sans suivi et sans écoute des actrices de terrain, elle risque de rester un bel exercice de communication.
L’heure est donc venue de transformer les mots en actes.
Parce qu’une diplomatie féministe, ce n’est pas une vitrine.
C’est un engagement politique, concret et durable, au service des droits et des vies des femmes du monde entier.
Décryptage Desculottées
🔸 Un cap clair : la France veut faire de l’égalité de genre un levier diplomatique global, pas seulement une “cause sociale”.
🔸 Une priorité forte : les droits sexuels et reproductifs, dont l’avortement sécurisé, deviennent la pierre angulaire de la stratégie.
🔸 Un défi majeur : sans financements pérennes ni suivi transparent, la diplomatie féministe française restera une promesse sur papier.