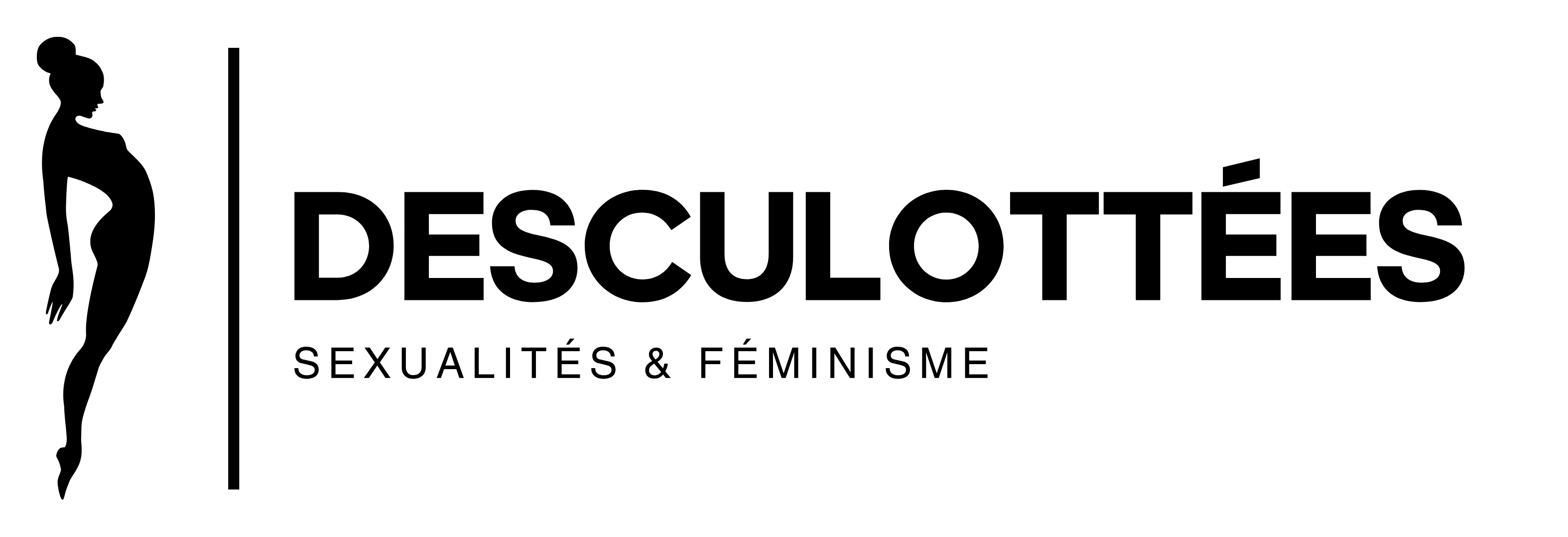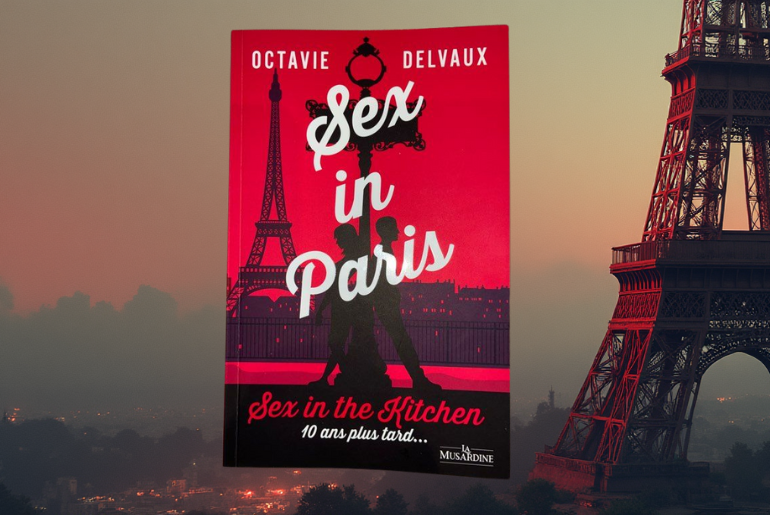Ce 29 octobre 2025, le Sénat a voté l’inscription du non-consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Une victoire historique pour les droits des femmes. Cela aligne enfin la législation française sur les standards internationaux de protection des victimes et sur l’esprit de la Convention d’Istanbul. Une avancée symbolique et concrète, au cœur du combat contre la culture du viol.
Un vote historique au Sénat
C’est un jour à marquer d’une pierre violette : le 29 octobre 2025, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi inscrivant le non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles. Concrètement, l’article 222-22 du Code pénal sera réécrit pour préciser que « tout acte sexuel sans consentement libre et éclairé constitue une agression sexuelle ou un viol ». Jusqu’à présent, la loi ne reconnaissait le viol qu’à travers les notions de violence, contrainte, menace ou surprise — un cadre qui rendait de nombreuses victimes inaudibles, notamment dans les cas de sidération ou d’emprise.

Cette réforme, soutenue par le Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, est qualifiée de « tournant dans la lutte contre la culture du viol » : elle déplace enfin le regard de la victime vers l’acte lui-même.
« Ce vote met fin à une vision archaïque où le silence ou la peur étaient interprétés comme un consentement implicite. » – Ministère de l’Égalité (communiqué du 29 octobre 2025)
À lire aussi : Je suis ordinaire : court-métrage sur le viol conjugal
Une avancée concrète pour les victimes
L’ajout du non-consentement clarifie la loi et la rend plus juste :
- Juridiquement, les magistrat·es disposeront désormais d’un texte qui reconnaît les réalités psychologiques de la violence sexuelle : la peur, la sidération, l’impossibilité de dire non.
- Symboliquement, la société envoie un signal fort : sans consentement, il n’y a pas de relation sexuelle possible.
- Socialement, cela renforce l’éducation et la prévention autour de la sexualité, comme l’explique notre article Le consentement dans le couple : pourquoi et comment en parler.
Chaque année, en France, plus de 230 000 femmes sont victimes de violences conjugales et 115 000 de violences sexuelles, selon le ministère. Pourtant, seulement 3 % des viols aboutissent à une condamnation. Ces chiffres glaçants rappellent l’urgence de transformer le droit en protection réelle.
Cette loi redonne de la dignité à des milliers de femmes dont la parole a été minimisée ou niée. »
Sénatrice Dominique Vérien, rapporteuse du texte
S’aligner avec la Convention d’Istanbul
Ce changement législatif n’est pas isolé : il s’inscrit dans un mouvement européen impulsé par le traité d’Istanbul, signé en 2011 sous l’égide du Conseil de l’Europe. Cette convention impose aux États de prévenir, sanctionner et éradiquer les violences faites aux femmes. Elle définit le viol comme tout acte sexuel commis sans le consentement libre de la personne.
En adoptant cette réforme, la France rejoint les pays qui appliquent pleinement la Convention d’Istanbul, alors que plusieurs États membres — comme la Hongrie ou la Slovaquie — refusent toujours de la ratifier. Mais, comme le souligne le rapport du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes), des failles persistent : manque de moyens, disparités territoriales, formation insuffisante des forces de l’ordre et de la justice.
À lire aussi : Sortir de la culture du viol : des pistes de réflexion
Un pas de plus vers une politique plus féministe ?
Ce vote s’inscrit pleinement dans la stratégie 2025-2030 de diplomatie féministe française, qui s’engage à promouvoir l’égalité dans toutes ses politiques, y compris internationales. Cette évolution du droit pénal illustre une cohérence entre discours et actes : renforcer la justice pour les femmes en France, c’est aussi renforcer la crédibilité de la France à l’étranger.
À lire aussi : Prix #MeTooMedia : récompenser le journalisme contre les violences sexistes
Comme en Belgique, où une loi contre le féminicide a été adoptée en 2024, la France démontre qu’un cadre législatif clair est nécessaire pour lutter contre les violences sexuelles sexistes. Cependant, les lois seules ne suffisent pas — elles doivent s’accompagner de politiques publiques fortes, de moyens et d’une éducation à l’égalité dès le plus jeune âge — même si elles envoient un signal fort.
L’inscription du non-consentement dans la loi, c’est une victoire du féminisme. C’est aussi une invitation à repenser nos rapports sociaux, amoureux et intimes.
Lire aussi nos articles :