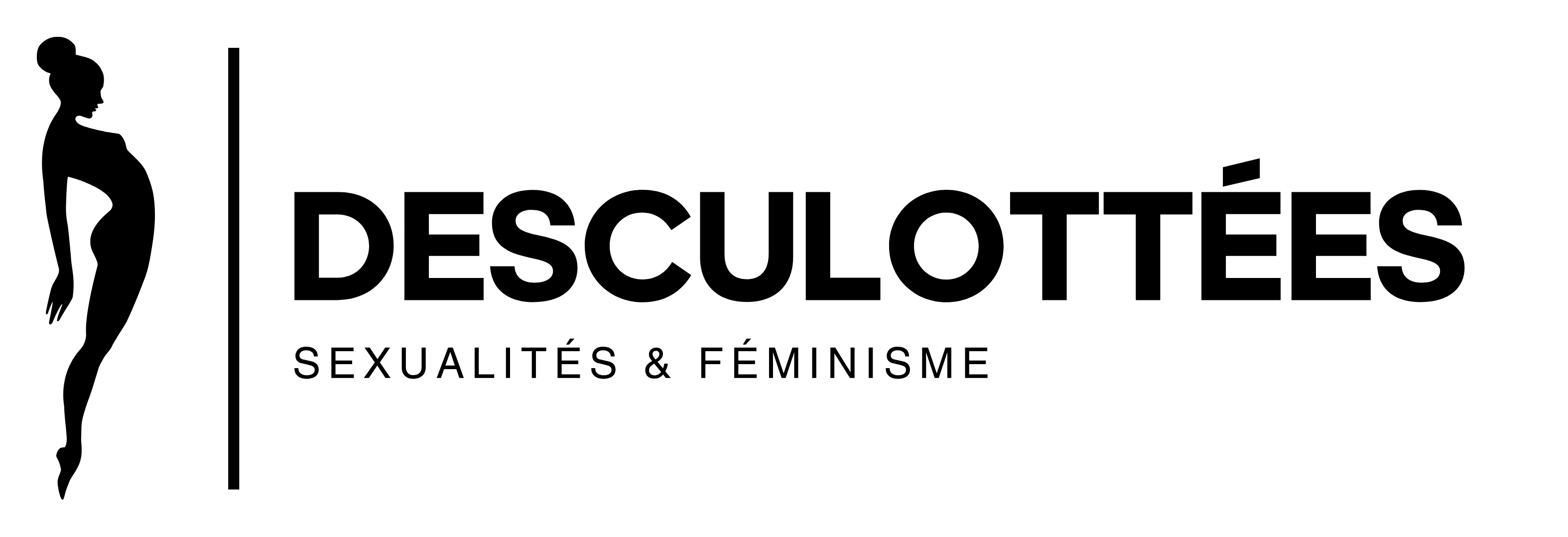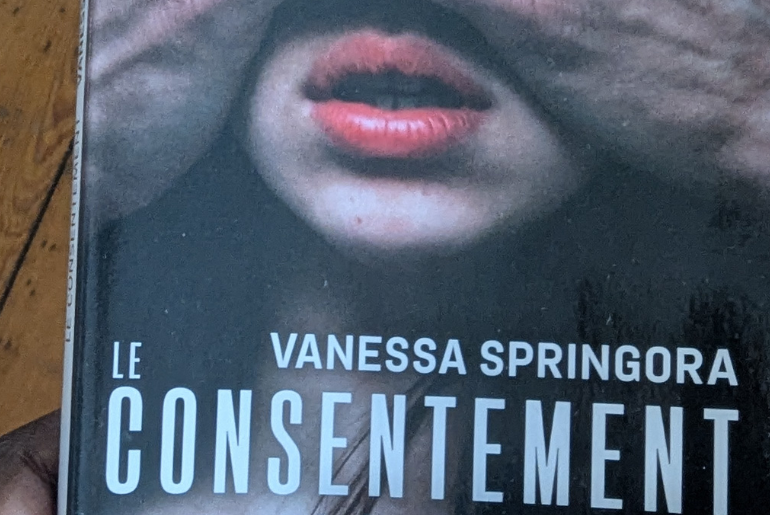Elles prônent le retour à la maison, la soumission choisie, et un idéal de féminité soigneusement mis en scène. Les tradwives, ou « épouses traditionnelles », prolifèrent sur les réseaux sociaux. Mais derrière leurs sourires vintage et leurs tartes maison se cache une idéologie antiféministe bien plus inquiétante.
Retour en arrière : la femme au foyer comme idéal bourgeois
L’image idéalisée de la femme au foyer, douce, dévouée et bien mise, a été largement construite après les deux guerres mondiales, dans un contexte de reconstruction des sociétés occidentales. Cet idéal concerne principalement les femmes blanches et bourgeoises : elles ont désormais pour mission de tenir un intérieur impeccable, élever les enfants, tout en incarnant un pilier moral et esthétique pour leur mari.
Mais cette norme n’était pas accessible à toutes. Les femmes précaires, racisées ou issues des classes populaires travaillaient souvent à l’extérieur, dans des conditions pénibles, et cumulaient les charges du foyer. Ce modèle de « féminité » universelle était en réalité excluant et profondément classiste et raciste.
Puis, les mouvements féministes de la seconde vague ont bousculé l’ordre établi. À partir des années 70, les femmes revendiquent leur autonomie financière, leur droit au plaisir sexuel, à l’avortement, à l’éducation, à la liberté vestimentaire. La figure de la femme indépendante devient un symbole d’émancipation. Mais derrière les grandes avancées juridiques et sociales, des inégalités tenaces perdurent jusqu’aujourd’hui. La charge mentale, la précarité et les violences patriarcales continuent de peser.
L’avènement des tradwives 2.0, un pur produit marketing
Sur Instagram et TikTok, une nouvelle génération de femmes met en scène un quotidien réactionnaire fantasmé. Robes fleuries, sourires Colgate, confitures maison, dévotion pour leur mari et rejet explicite du féminisme, sont leurs attributs.
Les tradwives (contraction de traditional wives) ne prônent pas seulement un retour à la maison : elles revendiquent pleinement le retour à des rôles genrés stricts. Le hashtag #tradwife cumule des millions de vues, et derrière les vidéos de pique-niques vintage se cache une vision rétrograde du rôle des femmes.
Les tradwives sont de purs produit marketing qui renforcent des idéaux antiféministes, via des images léchées. Certaines cumulent plusieurs milliers de followers sur les réseaux sociaux, alors que leur vie réelle n’a rien à voir avec l’image diffusée. Cependant, elles en profitent pour monétiser leurs contenus et s’associer avec des marques, en jouant sur le « c’était mieux avant ».
La récupération conservatrice des tradwives
Ce retour de la « bonne épouse » est largement récupéré par des sphères politiques ultra-conservatrices, voire d’extrême droite. Ils s’emparent de l’esthétique tradwife pour réaffirmer un ordre patriarcal, où la femme reste à sa place : silencieuse, obéissante, au service de l’homme et de la nation. Et quand le Président de la République, Emmanuel Macron, incite au réarmement démographique de la nation, cela ne fait que souffler sur les braises de cette mouvance réactionnaire.

Une utopie antiféministe face à l’effondrement du monde
Les tradwives prétendent que c’est le féminisme qui cause du tort aux femmes et non le patriarcat. Il est vrai que face à l’épuisement lié à la double journée (travail + foyer), à l’absence de partage des tâches domestiques, et à l’injonction permanente à être « forte et indépendante », certaines femmes se sentent abandonnées. Les tradwives apparaissent alors comme une réponse à cette fatigue. Elles promettent un retour à l’ordre, à la simplicité, à une division claire des rôles. Leur discours peut paraître un refuge devant un monde trop complexe.
Dans notre époque marquée par l’écocide, l’insécurité économique et l’individualisme forcené, le fantasme d’une vie simple, autosuffisante et structurée devient séduisant. Le foyer devient une forteresse rassurante face au chaos.
Les vidéos tradwife sont esthétiques, rassurantes, voire apaisantes. Mais derrière les gestes doux se cachent des messages profondément antiféministes : abandon de l’autonomie, culte de la soumission, essentialisation des rôles genrés.
Ce phénomène renforce des normes patriarcales toxiques, au nom d’un choix personnel. Mais un choix peut-il être libre s’il est façonné par des siècles de domination, de marketing genré et de pressions sociales ?
De plus, cette vision fantasmée ignore les réalités systémiques et les privilèges de race et de classe qui permettent à certaines de « choisir » ce style de vie.
Whiteness, « clean girl » et passport bros : le backlash conservateur globalisé
Les tradwives sont presque exclusivement blanches, minces, hétéros. Leur esthétique se rapproche du trend « clean girl » : une féminité lisse, épurée, silencieuse, dépourvue de revendications et de tatouages. Une image qui gomme les luttes féministes, antiracistes et queer. Finalement, c’est une esthétique qui se rapproche fort du féminisme washing du film Barbie.
En parallèle, le phénomène des passport bros (des hommes occidentaux qui partent chercher des « épouses soumises » dans les pays du Sud) alimente une même nostalgie sexiste d’un patriarcat décomplexé. Le tout forme un écosystème mondial de réactions face aux avancées féministes, où les corps des femmes restent des terrains de contrôle.
Nous devons résister à ce retour en arrière
Le succès des tradwives nous rappelle une chose essentielle : rien n’est jamais acquis. Il traduit aussi un vide laissé par un féminisme trop libéral et individualiste, qui a parfois négligé la réalité des luttes de terrain, la fatigue des mères solo, la charge mentale des femmes racisées, ou l’angoisse écologique qui pèse sur nos avenirs.
Alors, plutôt que de rejeter en bloc celles qui se réfugient dans ces illusions du passé, essayons d’écouter et de comprendre. Face à cela, nous devons poursuivre les récits plus justes et inclusifs.
Oui, on peut aimer cuisiner, prendre soin de sa maison ou de sa famille… sans pour autant renoncer à ses droits, à sa voix, à sa puissance. L’avenir doit être féministe, pas rétrograde.