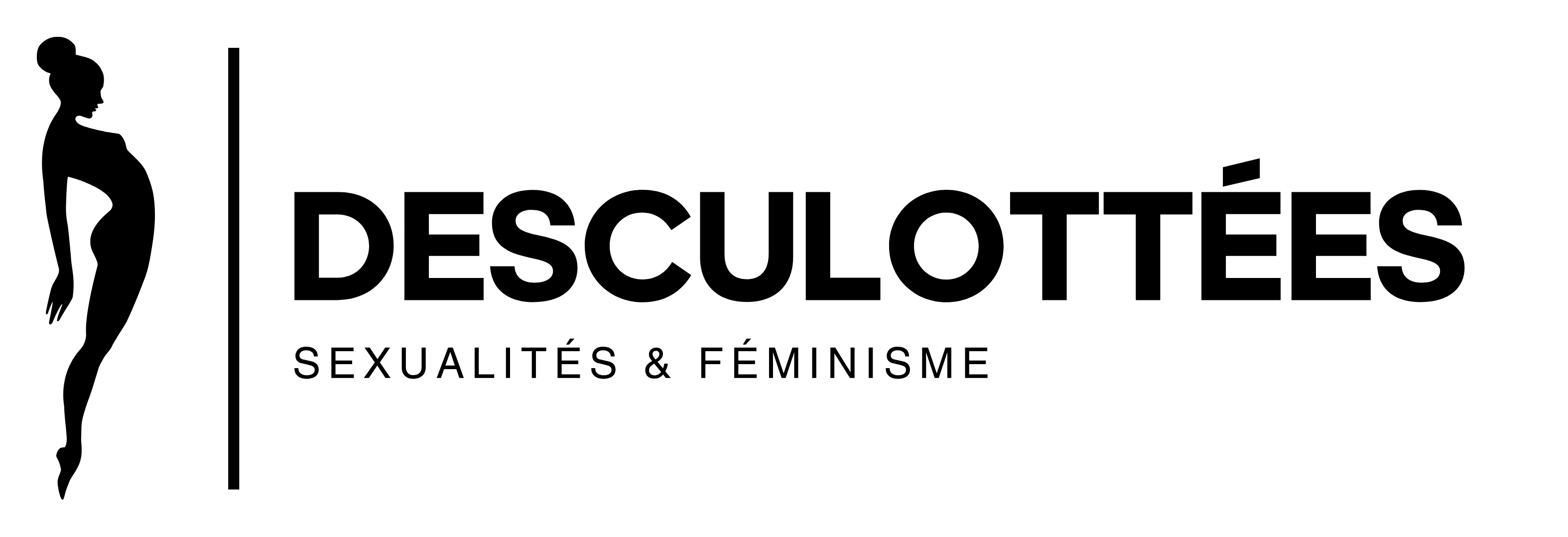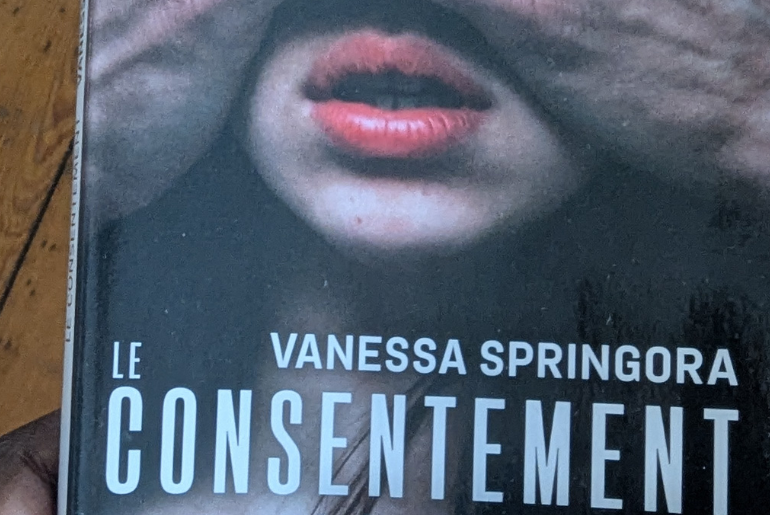Face à l’urgence climatique et à la persistance des inégalités de genre, l’écoféminisme s’impose comme un courant de pensée et d’action incontournable pour repenser notre monde. Né dans les années 1970, ce mouvement relie luttes écologistes et féministes pour dénoncer les racines communes de la destruction environnementale et de l’oppression patriarcale. À l’heure où les crises s’enchaînent, l’écoféminisme appelle à une transformation radicale de notre société.
Article mis à jour le 01 mai 2025
Qu’est-ce que l’écoféminisme ?
On serait tenté de faire un gentil raccourci, en mettant les termes écologie et féminisme dans un même shaker, de secouer fortement et d’obtenir l’écoféminisme. La recette est bien tentante mais la réalité est un tantinet plus complexe ! Vaste sujet autant par ses pratiques que par les pensées et polémiques qu’il sème, l’écoféminisme est avant tout un mouvement politique, altermondialiste et anticapitaliste. Loin d’être un simple slogan, l’écoféminisme est un mouvement politique, anticapitaliste et décolonial, qui interroge les structures de domination – qu’elles soient sexistes, racistes ou environnementales. Il prône une société égalitaire et durable, où les humains vivent en harmonie avec le vivant.
Pour bien comprendre toutes ses nuances et subtilités, il faudrait entreprendre un travail titanesque. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la philosophe Jeanne Burgart Goutal en menant sept ans d’enquête pour rédiger Être écoféministe : Théories et pratiques (L’échappée, 2020).
L’une des premières à avoir théorisé l’écoféminisme est Françoise d’Eaubonne, autrice et militante féministe, qui introduit le terme « éco-féminisme » en 1974 dans son essai Le Féminisme ou la Mort (réédité en 2020 par Le Passager clandestin). Elle y dénonce les ravages d’un capitalisme patriarcal destructeur, qui exploite à la fois les femmes et la nature. Pour elle, écologie et féminisme sont indissociables et doivent s’unir pour renverser le système.
Ėcoféminisme : de la théorie à l’action
Pour Françoise d’Eaubonne, pas de doute, la domination des femmes est indissociable de celle exercée sur la nature, dominations toutes deux issues du capitalisme patriarcal. L’oppression sexuelle, économique et sociale de la femme comme la surexploitation de l’écosystème sont unies par un même procédé de domination. C’est pourquoi, l’autrice préconise l’abolition du sexisme et du capitalisme patriarcal.
Ce sont les femmes et toutes les minorités exploitées qui doivent s’emparer du politique pour changer radicalement le système et construire un monde égalitaire, une « société au féminin qui serait le non-pouvoir » ! D’Eaubonne pense que l’enjeu écologique dépend aussi du contrôle de la procréation qui doit revenir aux femmes et non pas au fameux « lapinisme phallocratique ». Ce contrôle implique, bien entendu, la défense des droits à la contraception et à l’avortement. De cette façon, les femmes s’émancipent et préservent les ressources planétaires. Écologie et féminisme forment une interconnexion et mènent ainsi un même combat !

En France, la théorie d’Eaubonne ne prend pas et se répand très peu. C’est dans les pays anglophones, dans les années 1980, que ce courant de pensée émerge et donne naissance au mouvement pacifiste et antinucléaire Women and Life on Earth. Blocage de centrales et sit-in sont organisés par des militantes qui vont même jusqu’à s’enchaîner aux grilles du Pentagone (Women’s Pentagon Action) en opposition à la course à l’armement nucléaire. En s’enchaînant aux grilles du Pentagone, ces femmes rappellent que paix, justice sociale et écologie sont indissociables.
Ces actions s’inscrivent dans la logique du reclaim – se réapproprier le corps, la terre, et les savoirs – comme le montre le recueil Reclaim dirigé par la philosophe Émilie Hache, figure majeure de la pensée écoféministe contemporaine.
Il n’y a pas « un » mais « des » écoféminismes
L’écoféminisme n’est pas un courant homogène : il prend des formes diverses selon les contextes culturels et géographiques. Dans les pays du Sud, les enjeux sont liés à la survie : accès à l’eau, à la terre, à la nourriture. En Inde, dans les années 70, le mouvement Chipko voit des femmes s’interposer physiquement pour protéger les forêts de la déforestation.
La physicienne et militante Vandana Shiva, coautrice avec Maria Mies de Écoféminisme (1993, L’Harmattan), joue un rôle central dans la diffusion du courant. Elle dénonce le néocolonialisme écologique, la biopiraterie et les brevets sur le vivant imposés par les grandes multinationales, en particulier dans l’agro-industrie.
Aujourd’hui encore, des femmes comme Berta Cáceres (Honduras) ou Marina Silva (Brésil) incarnent cette lutte écoféministe au péril de leur vie.
Ecoféminisme en France : un mouvement qui tarde à démarrer
Longtemps en retrait, la France connaît depuis les années 2010 un renouveau écoféministe. Des collectifs émergent, comme Les Engraineuses, fondé en 2018 par Solène Ducrétot et Alice Jehan, qui organisent des événements, des ateliers, et ont lancé le festival écoféministe Après la Pluie.
Citons également Myriam Bahaffou, autrice de l’excellent livre Eropolitique, qui réinvente l’écoféminisme avec une approche intersectionnelle, queer et sensuelle. Elle appelle à une “écologie incarnée”, libérée des normes hétéronormées et occidentales.

Pourquoi l’écoféminisme est plus que jamais d’actualité ?
Aujourd’hui, les femmes représentent 80 % des réfugiés climatiques selon l’ONU. Les dérèglements climatiques, les conflits pour l’accès aux ressources, les pandémies et les violences systémiques touchent d’abord les plus vulnérables. L’écoféminisme rappelle que les inégalités de genre sont profondément liées à l’écocrise.
Il ne s’agit pas d’un combat réservé aux femmes, mais d’une invitation à repenser notre rapport au monde, à la consommation, au pouvoir et à la vie. L’écoféminisme, c’est une boussole pour construire des sociétés justes, durables, et inclusives.
Conseils de lecture pour aller plus loin :
- Le site des Engraineuses
- Reclaim, éd. Cambourakis, dir. Émilie Hache
- Ecoféminisme, de Maria Mies et Vandana Shiva, L’Harmattan
- Après la Pluie, collectif, Tana éditions
- Eropolitique, de Myriam Bahaffou, éd. Le Passager Clandestin