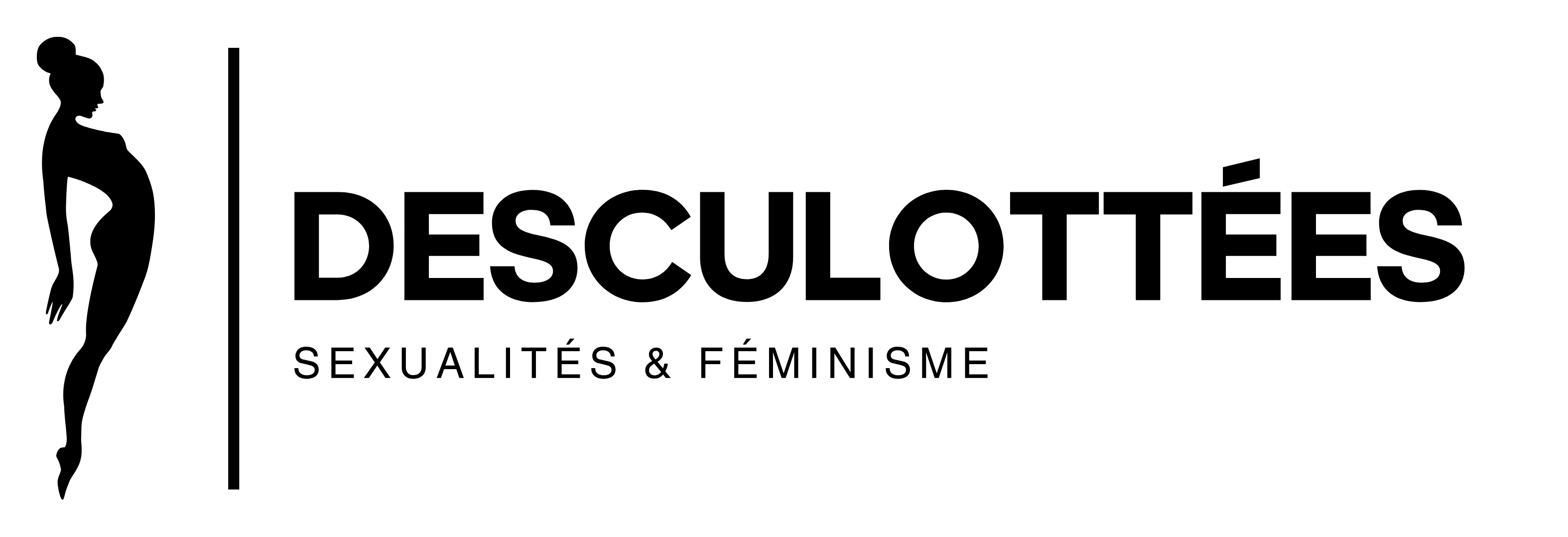Depuis toujours, nos douleurs sont normalisées, nos corps disséqués, nos vécus minimisés. On nous dit que « c’est normal », que « ça passera », mais nous savons que la discrimination médicale féminine est bien réelle : elle se chiffre, elle se prouve, elle se vit dans nos chairs. Et quand on est une femme racisée, noire en particulier, cette négligence peut même tuer.
Une médecine pensée pour l’homme, appliquée à la femme
La médecine moderne n’a jamais vraiment été faite pour nous. Les essais cliniques, en France comme ailleurs, se basent encore majoritairement sur des hommes blancs, jeunes et en bonne santé. Nos spécificités hormonales ? Trop « compliquées » à intégrer. Résultat : des retards de diagnostic, des effets secondaires ignorés, et ce chiffre froid mais parlant : les femmes mettent en moyenne 4 ans de plus que les hommes pour être diagnostiquées quand elles souffrent d’une maladie chronique. Et si nos douleurs ne sont pas comprises, c’est parce que nous ne faisons pas partie du modèle médical de référence.
Notre utérus est considéré comme une mécanique capricieuse, nos hormones comme une instabilité dangereuse. On nous pathologise à outrance — règles douloureuses, grossesse, ménopause — mais dès qu’il s’agit de réellement prendre soin de nous, il n’y a plus personne. Nous sommes sur-médicalisées et en même temps négligées. C’est le paradoxe du corps féminin.
Et n’allez pas croire que la violence s’arrête aux patientes. 54 % des femmes médecins disent avoir subi des violences sexistes ou sexuelles pendant leurs études ou leur pratique. Même dans la blouse blanche, le sexisme médical ne lâche rien. La médecine est un monde bâti par les hommes, pour les hommes — et ça se ressent dans chaque geste, chaque mot, chaque oubli.
La douleur féminine : normalisée, minimisée, invisibilisée
Combien de fois nous a-t-on dit « c’est dans ta tête », « sois forte », « toutes les femmes passent par là » ? La douleur féminine est une toile de fond invisible, banalisée à coup de phrases assassines comme « il faut souffrir pour être belle ».
Pendant ce temps, l’endométriose ronge des vies : une femme sur dix en France. Des ados pliées en deux, des adultes épuisées, des parcours de PMA sabotés. Et il a fallu attendre 2022 pour que l’endométriose soit enfin reconnue comme affection de longue durée. Des décennies de mépris, empaquetées dans un mot : « normal ».
À l’international, la prise de conscience avance plus vite : aux États-Unis, la fondation EndoFound et le Cold Spring Harbor Laboratory ont lancé un centre de recherche doté de 20 millions de dollars, dédié uniquement à l’endométriose. Un financement historique, qui rappelle combien la recherche française a encore du retard à rattraper.

Quand le sexisme médical croise le racisme
Être une femme, c’est déjà être mal soignée. Être une femme racisée, c’est encore pire.
On connaît toustes le cliché du « syndrome méditerranéen », cette idée nauséabonde selon laquelle les patient·es noir·es ou arabes exagéreraient leur douleur. En 2020, Noémie, 22 ans, est morte à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière parce que ses douleurs insoutenables ont été minimisées. Une vie envolée pour un préjugé raciste.
Ces discriminations s’inscrivent dans ce que la chercheuse afro-américaine Moya Bailey a nommé la misogynoir : une forme spécifique de violence qui mêle sexisme et racisme, et qui vise les femmes noires en particulier. La misogynoir produit une double peine : nos douleurs de femmes sont déjà minimisées, mais celles des femmes noires sont en plus suspectées, caricaturées, pathologisées.
Les statistiques parlent aussi : en France, les femmes immigrées d’Afrique ont 2,5 fois plus de risques de subir une discrimination médicale que les femmes blanches. Et quand on regarde les pathologies spécifiques, l’écart est vertigineux. Les fibromes utérins touchent les femmes noires trois fois plus. Lupita Nyong’o et Serena Williams en ont témoigné publiquement. Mais chez nous, combien de femmes noires continuent de souffrir dans le silence et la suspicion médicale ?
La pilule et le scandale silencieux de la contraception
Depuis plus de 60 ans, les femmes encaissent. Migraines, baisse de libido, risques cardiovasculaires, dépressions. Nous avons avalé la pilule de l’émancipation au prix de nos corps. Et quand, récemment, des essais ont testé une contraception hormonale masculine, on les a stoppés net, car les hommes ne supportaient pas les mêmes effets secondaires que nous vivons depuis des décennies. Pire encore : aujourd’hui, une pilule sans hormones, la YCT-529, est en développement… mais pour les hommes. Oui, on a trouvé le moyen de créer une contraception non hormonale pour eux, mais pas pour nous. Ce deux poids deux mesures résume à lui seul ce que vaut notre santé dans le système : sacrifiable.
Lire aussi : Comment choisir un·e gynécologue féministe et respectueux·se
Lire aussi : Arrêter la contraception hormonale, quels effets ?
Ménopause, un tabou qui ne devrait pas persister
La ménopause, ce grand silence. Pourtant, en France, 10 millions de femmes sont concernées et nous y passerons toutes. Bouffées de chaleur, insomnies, douleurs, anxiété… Et pourtant, qui en parle ? Dans nos familles, c’est un mot chuchoté. Dans les hôpitaux, un protocole vite expédié. Nos symptômes ne sont pas étudiés, pas accompagnés. Le corps féminin est toujours réduit à sa fonction reproductrice : fertile ou inutile.
À l’étranger pourtant, des initiatives commencent à émerger. Au Royaume-Uni, la chaîne de pharmacies Boots UK a créé des espaces dédiés à la ménopause dans plus de 150 magasins, proposant près de 400 produits ciblant les symptômes (bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, fatigue…). Une manière d’affirmer que la ménopause n’est pas une honte, mais un passage de vie qui mérite soutien et visibilité.
Et dans le domaine des innovations médicales, la start-up Uvisa Health vient de lever 600 000 dollars pour lancer des essais cliniques sur un traitement par luminothérapie des infections vaginales.
Briser le cycle de la discrimination médicale féminine
Il est temps de le dire clairement : la discrimination médicale féminine n’est pas un détail, c’est une structure. Elle traverse nos vies, nos douleurs, nos morts. Elle se double de racisme, d’âgisme, de classisme. Elle se lit dans les chiffres, mais surtout, elle se ressent dans nos chairs.
Nous ne sommes pas des organes défaillants à contrôler, ni des anomalies à soigner.
Nous sommes des corps vivants, désirants, souffrants, résistants. Et nous exigeons une médecine féministe, inclusive, qui cesse enfin de nous pathologiser pour commencer à nous écouter.
Lire aussi : Octobre Rose, j’ai eu un cancer du sein à 20 ans